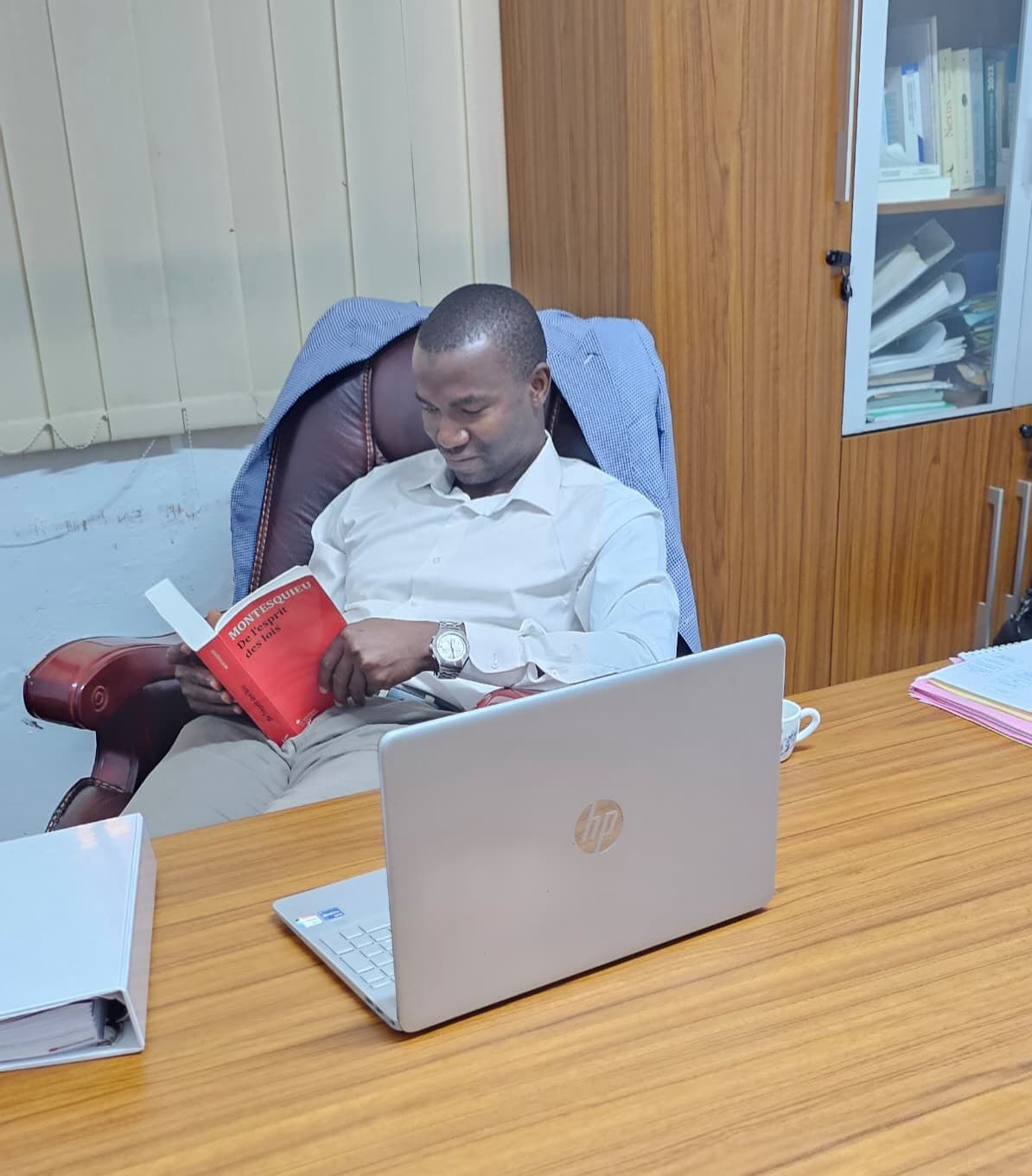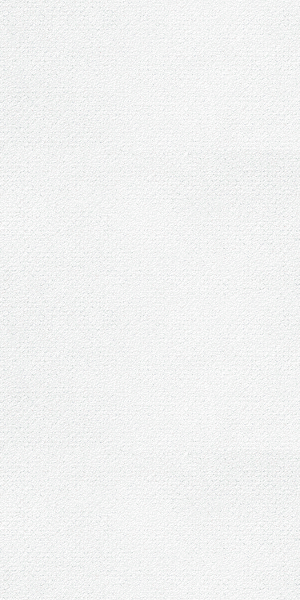La montée du sentiment anti-français en Afrique est aujourd’hui une réalité difficilement contestable. De plus en plus de voix s’élèvent sur le continent pour remettre en cause la politique africaine de la France, souvent perçue comme néocoloniale et paternaliste.
Cette hostilité ne surgit pas ex nihilo. Elle s’ancre dans une histoire longue et complexe, où l’ancienne puissance colonisatrice a souvent privilégié ses propres intérêts, occultant certains faits dans ses analyses diplomatiques et stratégiques. Le rejet de la politique française en Afrique puise également ses racines dans l’émergence de nouvelles élites africaines ( Ousmane Songo du Sénégal, et les leaders de l’AES) conscientes des enjeux de souveraineté et décidées à redéfinir les termes de la coopération.
La Françafrique, longtemps symbole de l’emprise française sur ses anciennes colonies, illustre bien cette relation déséquilibrée. Ce système visait à préserver les intérêts géostratégiques de la France tout en garantissant la stabilité des régimes amis, quitte à entraver les dynamiques démocratiques locales. Pendant plusieurs décennies après les indépendances, nombre de pays africains continuaient à déposer plus de 50 % de leurs réserves de change auprès du Trésor français, un fait souvent décrié comme un frein à leur autonomie économique.
Les répercussions de cette relation asymétrique furent nombreuses : manipulations politiques, soutien à des régimes autoritaires, voire implication supposée dans plusieurs coups d’État. Il serait cependant réducteur de ne voir dans la Françafrique qu’une entreprise néocoloniale : elle fut aussi un levier pour certains dirigeants africains désireux de se maintenir au pouvoir.
Avec la disparition de figures emblématiques de cette ère comme Omar Bongo, Gnassingbé Eyadéma, Félix Houphouët-Boigny et l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy en France, un tournant semblait s’amorcer. En 2012, François Hollande, nouvellement élu, annonçait sa volonté de tourner la page de la Françafrique. Pourtant, malgré un discours de rupture, son quinquennat fut marqué par plusieurs interventions militaires en Afrique : l’opération Serval au Mali (2013), Sangaris en Centrafrique (2013), et surtout Harmattan en Libye (2011), qui participa à la chute du régime Kadhafi.
L’intervention en Libye reste, aux yeux de nombreux jeunes Africains, un point de non-retour. Elle a précipité l’effondrement de l’État libyen, favorisé la circulation des armes, le terrorisme et l’instabilité dans toute la région sahélienne. Plusieurs chefs d’État africains avaient pourtant exprimé leur opposition à cette opération, anticipant ses conséquences désastreuses. Beaucoup considèrent que le colonel Kadhafi a payé le prix de sa vision panafricaniste et de son ambition de créer une monnaie unique africaine, perçue comme une menace pour l’ordre économique établi.
L’assassinat de Kadhafi est vécu comme une blessure profonde : il était vu par beaucoup comme un symbole d’émancipation politique, économique et sociale pour le continent.
Outre ces éléments, l’hostilité croissante à l’égard de la France repose sur un enchaînement d’interventions militaires peu efficaces à long terme. En dix ans, la France a lancé sept opérations sur le continent. Officiellement justifiées par le soutien aux armées africaines, elles sont de plus en plus perçues comme intrusives et inefficaces face à l’aggravation de l’insécurité.
Par ailleurs, la France semble souffrir d’un déficit de compréhension fine des dynamiques africaines actuelles. L’Afrique d’aujourd’hui n’est plus celle des années 1960 ou 1990. Une jeunesse connectée, informée, et revendicative émerge, portée par les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Elle exige un partenariat d’égal à égal, fondé sur le respect mutuel, la transparence et la réciprocité.
La France ne peut ignorer ces mutations. Elle doit repenser sa politique étrangère en Afrique, en s’appuyant sur des relais diversifiés : sociétés civiles, entrepreneurs, mouvements sociaux et non uniquement sur les pouvoirs en place. Elle doit également adapter son approche sécuritaire en privilégiant la formation, l’équipement et l’assistance technique des forces armées africaines plutôt que les interventions directes.
Sur le plan politique, il convient de reconnaître la diversité des cultures démocratiques africaines. Si la démocratie est un idéal universel, elle doit être enracinée dans les réalités locales. L’accompagnement français pourrait ainsi s’orienter vers le renforcement technique des institutions, tout en respectant les spécificités de chaque pays.
Enfin le sommet Afrique-France à Montpellier, bien que présenté comme un geste d’ouverture envers la jeunesse africaine, a été perçu par certains comme une opération de communication. Les participants n’étaient pas tous représentatifs de la diversité des sociétés africaines, et beaucoup regrettent que ce sommet n’ait pas été organisé sur le continent.
En conclusion : pour un partenariat rénové
L’Afrique n’est plus disposée à accepter des relations fondées sur la domination ou la condescendance. Elle réclame un partenariat sincère, tourné vers le développement, la sécurité partagée et le respect des peuples. La France, si elle souhaite conserver un rôle en Afrique, doit écouter, comprendre et surtout, évoluer.
Aboubacar Sidiki Camara Politologue DGA/AGETIPE.