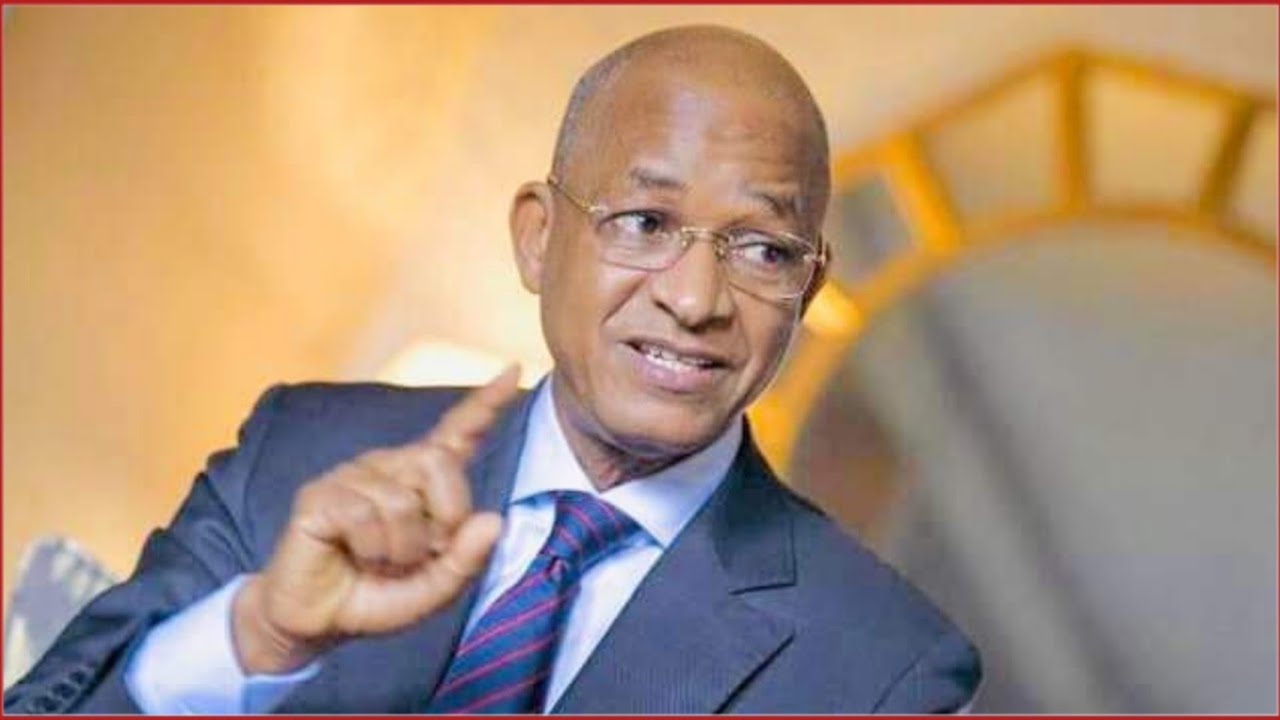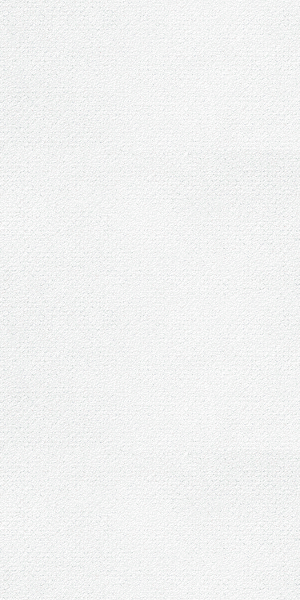Dans l’une de mes précédentes tribunes publiées, j’ai relevé le constat selon lequel la conjoncture géopolitique mondiale impose à chaque pays de ne pas compter fondamentalement sur un autre, car la loi du plus fort se manifeste à nouveau.
J’ai également évoqué la nécessité de bâtir des partenariats solides fondés sur les investissements directs étrangers plutôt que sur l’aide publique au développement, que je considère comme un frein à l’épanouissement des nations bénéficiaires.
Dans cette tribune, nous abordons la question du développement local. Selon moi, c’est sur ce plan que l’État et les communautés doivent concentrer le plus d’efforts et agir en synergie.
Parmi les leviers du développement local figurent la gouvernance, l’éducation, les infrastructures et la production. En agissant sur ces aspects avec rigueur et méthode, nous pourrons bâtir une économie et une société solides et résilientes, capables de surmonter les défis actuels et futurs.
La question que chacun se pose actuellement est la suivante : comment y parvenir ?
Les solutions sont multiples et variées, et dépendent de la problématique posée. Ne pouvant pas toutes les aborder dans une seule tribune, prenons l’exemple de l’amélioration de la production locale.
En Guinée, l’agriculture, l’élevage et la pêche constituent les principales activités de production de base. Elles emploient une grande majorité de la population, avec un rendement qui peine à garantir l’autosuffisance alimentaire du pays. Cet état de fait s’explique, entre autres, par le manque d’infrastructures routières facilitant le transport de la production rurale vers les grandes agglomérations, par l’insuffisance de l’électricité et des capacités de conservation des produits, ainsi que par l’absence d’une industrie de transformation.
En attendant la mise en œuvre des initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures, nous pouvons miser sur la stratégie de spécialisation des zones de production, c’est-à-dire faire en sorte que les producteurs de chaque région ou préfecture se concentrent principalement sur un produit commun.
Les avantages d’une telle démarche sont multiples : accroissement de l’expertise locale, stimulation de l’innovation, réduction des coûts de transport grâce aux économies d’échelle, partage de savoir-faire entre producteurs et facilitation de l’implantation d’unités industrielles en raison de l’abondance de la matière première.
Ainsi, nous pourrons allier spécialisation régionale et diversification nationale de la production.
La matérialisation de cette politique nécessite une synergie d’actions entre l’État, les collectivités locales et les populations de base et la mise en place de mesures incitatives pour encourager la spécialisation régionale, avec des aides ciblées aux producteurs et un accompagnement technique adapté.
Cheick Alioune