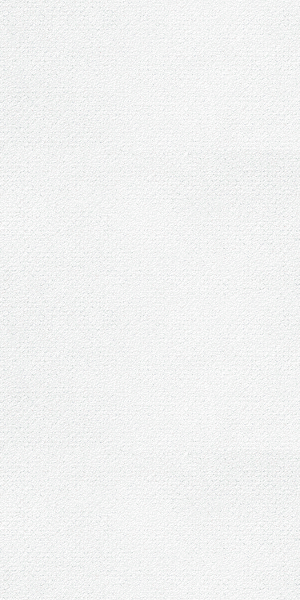Cela peut paraître paradoxal, mais je le dis et le réitère : la suspension des programmes d’aide apportée par les États-Unis à plusieurs pays est une bonne nouvelle ! Je précise d’emblée que je fais partie des personnes impactées par l’arrêt de certains programmes. L’un de mes contrats de consultant a été suspendu, car le projet pour lequel mon expertise était sollicitée était financé par l’USAID.
Cependant, je demeure persuadé que l’aide publique au développement est un mirage, un problème présenté comme une solution. D’abord, sur le plan des valeurs, l’aide établit un lien de subordination entre les États et les peuples, mettant à mal les principes de souveraineté. Elle engendre une dépendance et accentue la vulnérabilité des États bénéficiaires. On vous dira que l’aide publique au développement vise principalement à lutter contre la pauvreté, améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base et renforcer la gouvernance.
Mais qu’en est-il réellement ?
Prenons l’exemple de l’Afrique : les pays d’Afrique subsaharienne reçoivent bien plus d’aides que ceux du Maghreb, et pourtant, la pauvreté y est plus accrue. Parmi les plus grands bénéficiaires d’APD, on trouve la République démocratique du Congo, l’Ouganda et la Somalie, trois pays en proie à la mauvaise gouvernance, à la pauvreté et aux conflits interminables.
Certains diront que la situation de ces pays n’a rien à voir avec l’aide, et qu’il faut plutôt pointer du doigt la corruption et la mauvaise gouvernance. Il ne faut pourtant pas oublier que l’aide est un puissant outil d’influence géopolitique. Plus un pays dépend de l’aide, plus ses institutions sont faibles. Les donateurs influencent les choix politiques (chefs d’État, membres du gouvernement, députés, chefs militaires…) en fonction de leurs propres intérêts.
Les entreprises des pays donateurs exploitent les ressources des États bénéficiaires dans des conditions opaques, instaurant un commerce déloyal et inéquitable. Lorsqu’on analyse techniquement l’aide publique au développement, on se rend compte qu’une grande partie des fonds dits « donnés » retournent directement ou indirectement vers les pays donateurs, notamment à travers les coûts d’administration et la rémunération d’experts et consultants internationaux. Une autre partie se perd dans la corruption, et au final, seule une infime fraction atteint réellement les citoyens.
Certains donateurs fournissent du matériel et des équipements qui sont souvent des invendus de leurs chaînes industrielles, surévalués pour faire croire à une aide plus conséquente qu’elle ne l’est réellement.
Quelle alternative ?
Dans un contexte de mondialisation, la coopération bilatérale et multilatérale est indispensable pour améliorer la gouvernance et renforcer les infrastructures afin de garantir un meilleur accès aux services sociaux de base. C’est pourquoi nous devons œuvrer à l’établissement de partenariats équilibrés, en privilégiant les investissements directs étrangers (IDE). Il s’agit de permettre à des entreprises étrangères d’investir dans nos économies pour créer des richesses et des emplois, tout en respectant des principes stricts de transparence et d’équité.
Ainsi, nous pourrons mobiliser suffisamment de ressources internes pour financer notre propre développement et profiter du transfert de compétences et de technologies. La Chine a su adopter ce modèle, ce qui lui permet aujourd’hui de rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales. L’aide publique au développement rend les pays bénéficiaires paresseux, dépendants et vulnérables. Ce n’est pas une solution, mais un problème.
À bon entendeur, salut !
Cheick Alioune